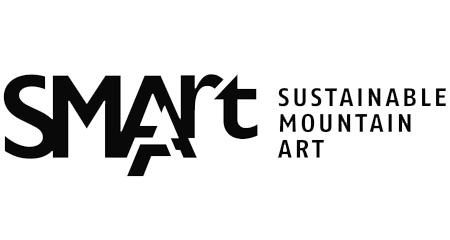Jacqueline Chabbi, née en 1943 dans le Finistère, est professeur honoraire des universités.
Agrégée d'arabe et docteur ès Lettres, elle a enseigné jusqu'en 2011 en études arabes à l'université de Paris VIII, Elle a publié deux livres et de nombreux articles consacrés d'abord à l'histoire du soufisme et à la période des origines de l'islam. Elle a publié trois livres Le Seigneur des tribus, l'islam de Mahomet, Paris, Noésis, 1997 (rééd. CNRS, 2010, 2013) ; Le Coran décrypté, Figures bibliques en Arabie, Paris, Fayard, 2008 (rééd. Le Cerf, 2014) ; Les trois piliers de l'islam, Lecture anthropologique du Coran, Paris, Le Seuil, 2016.
Coran et anthropologie historique
Lire un texte du passé peut conduire à des résultats surprenants selon le mode de lecture qu'on lui applique. Celui qui cherche à "comprendre l'islam" comme on l'entend dire souvent, peut être tenté de se précipiter sur le livre sacré de cette religion mondiale, croyant y trouver des réponses à ses interrogations sur les musulmans contemporains. A son total insu, il ne fera qu'y projeter ce qu'il pense déjà. Cette difficulté n'a échappé ni aux exégètes des âges classiques de l'islam, ni aux savants d'aujourd'hui. On a tenté de résoudre le problème de multiples façons. On l'a fait notamment en tentant de rapporter le texte du Coran à la chronologie d'une révélation qui s'inscrirait dans l'itinéraire de vie de Muhammad. Mais alors le problème est celui du décalage chronologique entre la fermeture du corpus coranique à la fin du VIIe siècle et la production des premiers écrits portant sur la vie de Muhammad qui apparaissent seulement un siècle plus tard dans une société qui n'est plus configurée sur le modèle ethno-tribal de son origine. Pour tenter d'échapper au risque redouté de l'anachronisme, l'une des voies les plus prometteuses paraît être celle de l'anthropologie historique. Appliquée à la lecture du texte coranique, elle permet de poser des hypothèses de vraisemblance historique qui ne se laissent pas abuser par la reconstruction sacralisante du passé qui caractérise les sources postérieures.

© 2025 - Château Mercier : Case postale 403 - 3960 Sierre / Suisse - Contacts - Inscription Newsletter